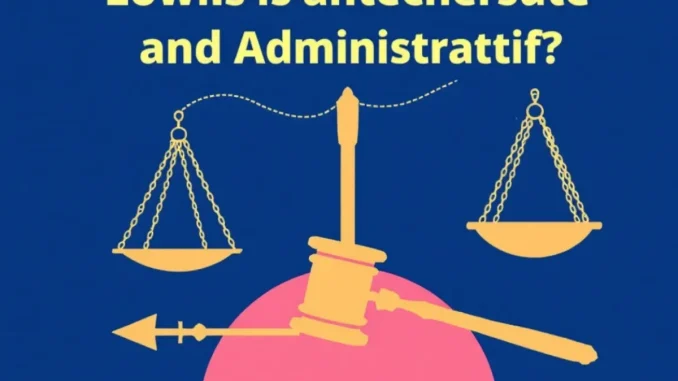
La médiation s’impose progressivement comme une voie privilégiée de résolution des litiges en droit administratif français. Face à l’engorgement des juridictions et à la complexification des relations entre administration et administrés, ce mode alternatif de règlement des différends offre une réponse adaptée aux enjeux contemporains. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle et le Code de justice administrative ont consacré cette pratique, lui donnant un cadre juridique précis. Entre avantages procéduraux, économies financières et préservation des relations, la médiation administrative présente des atouts considérables, tout en soulevant des questions sur sa place dans un système traditionnellement marqué par la puissance publique et la légalité administrative.
Fondements juridiques et évolution de la médiation administrative
La médiation administrative s’est développée progressivement dans le paysage juridique français, répondant à un besoin de modernisation des relations entre l’administration et les citoyens. Son cadre normatif s’est construit par strates successives, témoignant d’une reconnaissance grandissante de ce mode alternatif de règlement des conflits.
Historiquement, le droit administratif français, marqué par l’empreinte du principe de légalité et des prérogatives de puissance publique, semblait peu compatible avec les logiques de négociation inhérentes à la médiation. Toutefois, dès les années 1970, l’institution du Médiateur de la République (devenu Défenseur des droits en 2011) a constitué une première étape vers l’intégration de logiques médiatives dans les rapports administratifs.
La véritable consécration législative est intervenue avec la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ce texte fondateur a inséré dans le Code de justice administrative (CJA) un chapitre entier dédié à la médiation (articles L.213-1 à L.213-10). L’article L.213-1 du CJA définit désormais clairement la médiation comme « tout processus structuré […] par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur ».
Le décret d’application n°2017-566 du 18 avril 2017 a précisé les modalités pratiques de mise en œuvre de la médiation administrative, notamment concernant la désignation des médiateurs et le déroulement du processus. Cette évolution normative témoigne d’une volonté d’institutionnaliser la médiation comme outil à part entière de gestion des contentieux administratifs.
Plus récemment, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a renforcé le recours à la médiation en instaurant, à titre expérimental, une médiation préalable obligatoire (MPO) pour certains contentieux. Cette expérimentation, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2021, a été pérennisée par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Typologies de médiation administrative
Le cadre juridique actuel distingue trois formes principales de médiation administrative :
- La médiation à l’initiative des parties (art. L.213-5 du CJA) : démarche volontaire engagée directement par l’administration et l’administré
- La médiation à l’initiative du juge (art. L.213-7 du CJA) : proposée par la juridiction administrative saisie d’un litige
- La médiation préalable obligatoire (MPO) : condition de recevabilité du recours contentieux dans certaines matières spécifiques
Cette diversité de formats illustre la souplesse voulue par le législateur pour adapter la médiation à différents contextes contentieux. La jurisprudence administrative, notamment celle du Conseil d’État, contribue progressivement à préciser les contours et modalités d’application de ces dispositifs, consolidant ainsi l’ancrage de la médiation dans le paysage juridique administratif français.
Champ d’application : quand recourir à la médiation administrative ?
La médiation administrative offre un champ d’application particulièrement étendu, bien que certaines limites existent. Comprendre précisément quand ce dispositif peut être mobilisé constitue un enjeu fondamental pour les praticiens comme pour les usagers du service public.
En principe, l’article L.213-3 du Code de justice administrative pose une règle d’application générale : « Sauf en matière de mise en œuvre de l’article L.4 [exécution des décisions de justice], la médiation peut porter sur tout ou partie d’un litige ». Cette formulation témoigne d’une volonté du législateur d’ouvrir largement la voie médiatrice dans le contentieux administratif.
Dans la pratique, plusieurs domaines se révèlent particulièrement propices à la médiation :
- Les litiges relatifs à la fonction publique : questions d’avancement, mobilité, rémunération, conditions de travail
- Les contentieux sociaux : prestations sociales, aides publiques, logement social
- Les litiges contractuels : marchés publics, délégations de service public, contrats administratifs divers
- Les contentieux d’urbanisme : autorisations d’urbanisme, aménagements
- Les conflits de voisinage avec des établissements publics
La médiation préalable obligatoire (MPO) représente un cas particulier puisqu’elle impose le recours à la médiation avant toute saisine du juge administratif. Son champ d’application est strictement défini par les textes. Actuellement, elle concerne notamment :
– Certains litiges de la fonction publique impliquant des agents publics
– Des décisions relatives aux prestations sociales spécifiquement désignées
– Certains contentieux territoriaux dans des départements expérimentaux
Les limites au recours à la médiation
Malgré cette large ouverture, plusieurs catégories de litiges demeurent peu adaptées ou explicitement exclues du champ médiationnel :
D’abord, les questions d’ordre public et celles touchant aux compétences régaliennes de l’État restent généralement hors du champ de la médiation. Par exemple, les contentieux relatifs à la police administrative, à la sécurité publique ou aux mesures d’éloignement des étrangers se prêtent difficilement à une logique médiatrice.
Ensuite, certaines matières sont expressément exclues par les textes. L’article L.213-6 du CJA précise que « les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux différends qui s’élèvent entre l’administration et ses agents concernant leurs relations de travail », sauf exceptions définies par décret. Cette limitation a toutefois été assouplie par l’instauration de la MPO dans certains domaines de la fonction publique.
Enfin, les contentieux objectifs de légalité, notamment les recours pour excès de pouvoir dirigés contre des actes réglementaires, apparaissent moins propices à la médiation que les litiges subjectifs. Le principe d’indisponibilité des compétences administratives et le caractère d’ordre public de nombreuses règles limitent la marge de manœuvre des parties.
Il convient de noter que la temporalité joue également un rôle déterminant. La médiation peut intervenir à différents stades :
– En phase précontentieuse, avant toute saisine du juge
– En cours d’instance, suspendant alors l’instruction du dossier
– Même après une décision juridictionnelle, concernant ses modalités d’application
Cette flexibilité temporelle constitue un atout considérable, permettant d’envisager la médiation comme un outil mobilisable tout au long du parcours contentieux administratif.
Avantages stratégiques de la médiation pour les parties
Opter pour la médiation administrative représente un choix stratégique dont les bénéfices dépassent largement la simple éviction du contentieux classique. Pour les parties prenantes, qu’il s’agisse de l’administration ou des administrés, cette approche alternative offre des avantages tangibles et multidimensionnels.
En premier lieu, la dimension temporelle constitue un argument majeur. Face aux délais d’instruction et de jugement parfois considérables devant les juridictions administratives (pouvant atteindre plusieurs années pour certains contentieux), la médiation propose un traitement nettement plus rapide. La durée moyenne d’une médiation administrative se situe entre trois et six mois, permettant aux parties d’obtenir une résolution dans des délais raisonnables. Cette célérité répond tant aux attentes des usagers qu’aux objectifs de bonne administration poursuivis par les services publics.
L’aspect économique représente un second avantage considérable. Les coûts directs et indirects d’un contentieux administratif classique s’avèrent souvent élevés : frais d’avocats, expertises judiciaires, mobilisation des ressources humaines internes pour constituer les dossiers, sans compter l’éventuel impact financier d’une condamnation. La médiation, bien que nécessitant la rémunération du médiateur (généralement partagée entre les parties), permet de réduire significativement ces dépenses. Pour l’administration publique, c’est également un moyen de maîtriser les deniers publics en évitant des condamnations potentiellement lourdes.
Sur le plan relationnel, la médiation préserve, voire restaure, le lien entre l’administration et les usagers. Contrairement à la procédure contentieuse traditionnelle, intrinsèquement adversariale et souvent clivante, le processus médiationnel favorise le dialogue constructif et la compréhension mutuelle. Cette dimension s’avère particulièrement précieuse dans les situations où les parties devront maintenir des relations durables après la résolution du différend (relations employeur-agent public, relations entre collectivités territoriales et usagers réguliers, etc.).
Maîtrise des solutions et confidentialité
L’un des atouts majeurs de la médiation réside dans la maîtrise des solutions qu’elle offre aux parties. À la différence du contentieux classique où la décision est imposée par le juge administratif, la médiation permet aux protagonistes de construire ensemble une réponse adaptée à leurs besoins spécifiques. Cette co-construction favorise l’émergence de solutions créatives, parfois impossibles à obtenir dans le cadre rigide du procès administratif.
La confidentialité du processus représente un avantage stratégique considérable, particulièrement pour l’administration. L’article L.213-2 du Code de justice administrative garantit que « les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties ». Cette protection permet d’aborder franchement des sujets sensibles sans craindre que les positions exprimées ne soient ultérieurement utilisées dans un contexte contentieux.
Pour les personnes publiques, la médiation offre l’opportunité de réexaminer certaines décisions administratives sans perdre la face, dans un cadre préservé des regards extérieurs. Pour les administrés, elle permet d’exprimer des griefs et d’obtenir des explications sans s’exposer publiquement.
Enfin, la médiation administrative présente l’avantage de la sécurité juridique. L’accord issu de la médiation peut être homologué par le juge administratif, lui conférant force exécutoire selon les dispositions de l’article L.213-4 du CJA. Cette homologation transforme l’accord en véritable titre exécutoire, garantissant son application effective tout en préservant les principes fondamentaux du droit public.
Processus et acteurs : comment se déroule une médiation administrative ?
Le déroulement d’une médiation administrative suit un processus structuré mais flexible, adapté aux spécificités du droit public. Comprendre ses étapes et identifier les acteurs impliqués permet d’appréhender pleinement cette démarche alternative de résolution des différends.
L’initiation du processus peut emprunter trois voies distinctes. Dans le cadre d’une médiation conventionnelle, les parties (administration et administré) conviennent ensemble de recourir à un médiateur avant toute saisine juridictionnelle. Pour la médiation à l’initiative du juge, c’est la juridiction administrative déjà saisie qui propose aux parties d’explorer cette voie, avec leur accord. Enfin, la médiation préalable obligatoire (MPO) constitue un passage imposé avant tout recours contentieux dans certaines matières spécifiques.
Une fois le principe de la médiation acté, la désignation du médiateur constitue une étape déterminante. Ce tiers impartial peut être choisi conjointement par les parties ou désigné par le juge. Selon l’article L.213-2 du Code de justice administrative, le médiateur doit présenter des garanties d’impartialité, de compétence et de diligence. Dans la pratique, plusieurs profils peuvent intervenir :
- Des médiateurs institutionnels comme le Défenseur des droits ou ses délégués territoriaux
- Des médiateurs internes à certaines administrations (médiateurs des ministères, des collectivités territoriales)
- Des médiateurs professionnels indépendants, souvent avocats, magistrats honoraires ou consultants spécialisés
- Des centres de médiation proposant des médiateurs formés au droit administratif
Déroulement des séances et méthodologie
Le processus médiationnel proprement dit s’articule généralement autour de plusieurs séances structurées. Après une réunion d’information préliminaire où le médiateur présente le cadre et les règles de la médiation, les parties sont invitées à exprimer leurs positions et attentes lors d’une phase d’exposé des faits.
Le médiateur utilise diverses techniques pour faciliter les échanges : écoute active, reformulation, questions ouvertes, entretiens individuels (caucus). Son rôle n’est pas de trancher le litige mais d’aider les parties à identifier elles-mêmes des solutions mutuellement satisfaisantes. La méthodologie employée vise à dépasser les positions de principe pour explorer les intérêts sous-jacents des parties.
Une spécificité de la médiation administrative réside dans la nécessaire prise en compte du principe de légalité. Contrairement à une médiation purement privée, les solutions envisagées doivent respecter le cadre légal et réglementaire applicable. Le médiateur doit veiller à ce que l’accord potentiel ne contrevienne pas aux principes fondamentaux du droit administratif comme l’égalité devant le service public ou l’intérêt général.
La représentation des parties constitue un aspect procédural important. Si la présence d’un avocat n’est pas obligatoire, elle s’avère souvent utile, notamment pour l’administré. Du côté de l’administration, la question de la compétence et du mandat pour transiger doit être soigneusement examinée. Les représentants publics doivent disposer d’une délégation suffisante pour engager valablement leur institution, conformément aux règles de la délégation de signature et de la compétence administrative.
L’issue du processus peut prendre différentes formes. En cas d’accord, celui-ci est formalisé par écrit et peut faire l’objet d’une homologation judiciaire selon les dispositions de l’article L.213-4 du CJA. Cette homologation, qui n’est pas automatique, intervient après vérification par le juge que l’accord ne contrevient pas aux règles d’ordre public. En cas d’échec, les parties retrouvent leur liberté d’action contentieuse, sans que les propositions échangées durant la médiation puissent être utilisées devant le juge, garantissant ainsi la confidentialité du processus.
La médiation administrative face aux défis contemporains
La médiation administrative s’inscrit dans un paysage juridique et social en pleine mutation. Son développement répond à des enjeux contemporains majeurs tout en soulevant de nouvelles questions sur la transformation des relations entre puissance publique et citoyens.
Face à l’engorgement chronique des juridictions administratives, la médiation offre une réponse pragmatique. Les tribunaux administratifs français font face à un afflux constant de requêtes, avec plus de 230 000 nouvelles affaires enregistrées annuellement. Dans ce contexte, le développement des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) répond à une nécessité pratique autant qu’à une vision renouvelée de la justice administrative. Les statistiques récentes du Conseil d’État montrent que les médiations aboutissent à un accord dans environ 60% des cas, contribuant significativement au désengorgement des prétoires.
La médiation s’inscrit également dans un mouvement plus large de transformation numérique de l’action administrative. L’essor des plateformes en ligne de médiation, comme Médiation.gouv.fr, facilite l’accès à ces dispositifs alternatifs. La crise sanitaire de 2020-2021 a accéléré cette tendance, avec le développement des médiations à distance par visioconférence. Cette dématérialisation présente des avantages en termes d’accessibilité mais soulève également des questions sur la préservation de la dimension humaine inhérente à tout processus médiationnel.
Sur le plan conceptuel, la médiation administrative participe à une redéfinition de la relation administrative. Traditionnellement marquée par la verticalité et l’unilatéralité, cette relation évolue vers des modèles plus horizontaux et participatifs. La loi ESSOC (État au service d’une société de confiance) du 10 août 2018 illustre cette tendance en promouvant le droit à l’erreur et une administration plus compréhensive. La médiation s’inscrit parfaitement dans cette évolution, favorisant le dialogue et la co-construction des solutions.
Défis et perspectives d’évolution
Malgré ses avantages, la médiation administrative fait face à plusieurs défis. Le premier concerne la formation des médiateurs en droit public. La spécificité du contentieux administratif, avec ses principes propres (légalité, intérêt général, compétence liée), exige une expertise particulière que tous les médiateurs généralistes ne possèdent pas nécessairement. Des initiatives comme le diplôme universitaire de médiateur administratif proposé par certaines facultés de droit tentent de répondre à cette problématique.
Un autre défi majeur réside dans l’équilibre des pouvoirs au sein du processus médiationnel. La relation administrative étant intrinsèquement asymétrique, le médiateur doit veiller à garantir une véritable égalité des armes entre l’administration, qui dispose de ressources juridiques considérables, et l’administré souvent moins armé face à la complexité du droit public. Cette question rejoint celle de l’accès au droit et de l’accompagnement juridique des citoyens dans leurs démarches.
Les perspectives d’évolution de la médiation administrative semblent prometteuses, avec plusieurs tendances se dessinant :
- L’extension progressive du champ de la médiation préalable obligatoire à de nouveaux domaines du contentieux administratif
- Le développement de médiations collectives pour traiter des litiges sériels impliquant plusieurs administrés
- L’intégration croissante de la médiation dans la formation initiale des agents publics et des juristes
- L’émergence de standards de qualité et de certification spécifiques aux médiateurs administratifs
La jurisprudence administrative joue un rôle déterminant dans cette évolution. Plusieurs décisions récentes du Conseil d’État ont précisé les contours de l’homologation des accords issus de médiation et la portée du principe de confidentialité. Ces clarifications jurisprudentielles contribuent à sécuriser le cadre juridique de la médiation et à renforcer son attractivité pour les parties.
Enfin, la dimension comparative internationale mérite attention. Plusieurs pays européens, comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, ont développé des systèmes avancés de médiation administrative dont la France pourrait s’inspirer. Le droit européen, notamment à travers les recommandations du Conseil de l’Europe sur les modes alternatifs de règlement des différends, encourage cette approche plus consensuelle des litiges administratifs.
Vers une culture administrative de la médiation
L’intégration durable de la médiation dans le paysage du droit administratif français nécessite une véritable transformation culturelle. Au-delà des textes et des procédures, c’est une nouvelle approche des relations entre administration et administrés qui se dessine progressivement.
Le développement d’une culture administrative de la médiation implique d’abord une évolution des mentalités au sein des services publics. Traditionnellement formés à l’application stricte des textes et à la défense des prérogatives administratives, les agents publics doivent désormais intégrer des compétences d’écoute, de dialogue et de recherche de solutions amiables. Cette transformation s’opère progressivement grâce à plusieurs leviers :
La formation initiale et continue constitue un vecteur essentiel. Les écoles de service public, comme l’ENA (devenue INSP) ou les IRA, intègrent désormais des modules sur les modes alternatifs de règlement des différends. De même, les formations proposées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) sensibilisent les agents territoriaux aux bénéfices de l’approche médiationnelle.
Le développement de réseaux de référents médiation au sein des administrations favorise la diffusion des bonnes pratiques. Plusieurs ministères et collectivités territoriales ont ainsi désigné des agents chargés de promouvoir et d’accompagner les démarches de médiation. Ces référents jouent un rôle d’interface entre les services opérationnels et les médiateurs externes, facilitant la mise en œuvre concrète des processus médiationnel.
Évaluation et mesure d’impact
La pérennisation de la médiation administrative passe également par une évaluation rigoureuse de ses résultats. Plusieurs indicateurs peuvent être mobilisés pour mesurer son efficacité :
- Le taux de réussite des médiations engagées (proportion aboutissant à un accord)
- La durée moyenne des processus de médiation
- Le coût comparatif par rapport aux procédures contentieuses classiques
- Le niveau de satisfaction des parties prenantes
- L’impact sur le stock des juridictions administratives
Les rapports annuels d’activité du Conseil d’État et des tribunaux administratifs intègrent désormais des données statistiques sur la médiation, permettant de suivre son développement quantitatif. Toutefois, l’analyse qualitative reste à approfondir pour mieux comprendre les facteurs de réussite ou d’échec des démarches médiatives.
L’approche préventive constitue une évolution prometteuse de la médiation administrative. Au-delà du règlement des litiges déjà cristallisés, la médiation peut intervenir en amont pour éviter l’émergence même du conflit. Cette dimension préventive s’illustre notamment dans les projets d’urbanisme ou d’aménagement où des médiateurs interviennent dès la phase de concertation publique pour faciliter le dialogue entre porteurs de projets publics et citoyens.
Le rôle des avocats publicistes mérite une attention particulière dans cette évolution culturelle. Traditionnellement formés à la défense contentieuse, ces professionnels adaptent progressivement leur pratique pour intégrer la dimension médiationnelle. Certains développent une double compétence d’avocat et de médiateur, particulièrement précieuse dans le contexte administratif où la maîtrise des règles de droit public reste indispensable.
Enfin, la médiation administrative s’inscrit dans une réflexion plus large sur la démocratie participative et la citoyenneté administrative. En promouvant l’implication active des administrés dans la résolution de leurs différends avec les services publics, elle contribue à renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté citoyenne et à restaurer la confiance dans les institutions.
Cette évolution vers une administration plus médiatrice et moins verticale ne signifie pas un affaiblissement de l’autorité publique, mais plutôt sa transformation vers des formes plus consensuelles et dialogiques. La puissance publique ne s’exprime plus uniquement par l’unilatéralité mais aussi par sa capacité à construire des solutions partagées et respectueuses des droits et intérêts de chacun.
